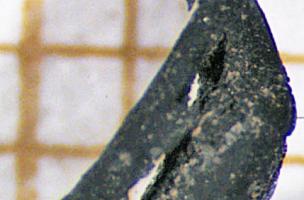Vous êtes ici
Loin du littoral : à Alba-la-Romaine, culture de la vigne dès l'âge du Fer
Des indices de culture de la vigne ont été découverts à l'occasion d'opérations de fouilles de l'Inrap à Alba-la-Romaine. Une étude multidisciplinaire, tend à indiquer que la vigne était cultivée dans le sud de l'Ardèche dès le Ve siècle avant notre ère.
La vigne, le raisin et le vin sont emblématiques des populations de la Méditerranée et de l'Europe. Il est admis que la romanisation a conduit à un développement rapide de la viticulture en Gaule, dès le Ier siècle avant notre ère. Le succès commercial du vin gaulois, matérialisé par la répartition de ses amphores, ne se dément pas jusqu’au IIIe siècle de notre ère. Mais des découvertes récentes, effectuées lors de fouilles de l’Inrap à Alba-la-Romaine (Ardèche), soulèvent la question de la culture précoce de la vigne, dès le Ve siècle avant notre ère, dans les terres éloignées de la côte méditerranéenne.
Des vignes dans les terres, dès l’âge du Fer
L’Inrap a mené trois fouilles archéologiques au lieu-dit La Grande Terre à Alba-la-Romaine, de 2013 à 2015, sur prescription de l’État (Drac Auvergne Rhône-Alpes). La commune est située dans le sud de l'Ardèche, à mi-chemin entre le Teil (dans la vallée du Rhône) et Aubenas où le vin actuellement produit se trouve dans le grand domaine des Côtes du Rhône. Elle est donc dans les terres, à environ 150 km des principaux sites portuaires côtiers méditerranéens.
Le site a livré la présence d'une occupation importante au cours de la Protohistoire. Les archéologues ont mis au jour des fossés et des résidus d'installations de forge et d'ateliers. Le comblement d’un fossé daté de la première moitié du Ve siècle avant notre ère a livré des ceps de vigne domestiques carbonisés, des pépins de raisin, des pollens de vigne, et des traces organiques de vin rouge dans les céramiques indigènes. Ces éléments témoignent d’une exploitation précoce de la vigne qui aurait été pratiquée à Grande Terre.
Un paysage forestier anthropisé…
Les vestiges bio-archéologiques récupérés ont fait l'objet d’une batterie d’analyses multidisciplinaire.
L'étude anthracologique (charbons) montre un paysage forestier en mosaïque qui constitue la frange la plus septentrionale des paysages de type méditerranéen. La palynologie précise que ce paysage est très anthropisé avec des activités agropastorales. Le blé, l'orge, la vesce, la lentille, la noisette et le raisin composent les plantes alimentaires (analyse carpologique).
...et des vignes
32 charbons de ceps de vigne carbonisés (Vitis vinifera cf. vinifera) et deux pépins de raisin carbonisé ont été identifiés. Le carbone 14 donne une datation entre 765 et 410 avant notre ère. L’étude éco-anatomique de ces charbons montre qu’à Alba-la-Romaine, des vignes cultivées (domestiquées) sont associées à d'autres de vigne sauvage, ce qui va dans le sens d’une culture précoce de la vigne.

Brandon de vigne carbonisé.
Inrap
Une viticulture précoce dans le sud Ardèche
Le site d’Alba-la-Romaine peut être comparé à certains sites archéologiques rhodaniens (Le Pègue, Tournon-sur-Rhône et Lyon-Vaise) ce qui plaide en faveur d’une viticulture/viniculture précoce dans les terres. Cette viticulture aurait été pratiquée à Alba-la-Romaine alors même que, sur la côte méditerranéenne colonisée, les Grecs produisent et commercialisent leur vin. D’autres découvertes seront nécessaires pour confirmer ce nouveau modèle qui vieillit l’introduction de la vigne dans les terres d’Ardèche de cinq siècles.
Contrôle scientifique : Service régional de l’archéologie (Drac Auvergne - Rhône-Alpes)
Recherche archéologique : Inrap
Responsable scientifique : Fabien Isnard, Inrap
Archéobotaniste : Manon Cabanis, Inrap, laboratoire Geolab
Équipe scientifique : Laurent Bouby (CNRS), Bertrand Limier (INRAE), Nicolas Garnier (Laboratoire N. Garnier), Benjamin Diètre (Chrono-Environnement), Sophie Martin (Inrap), Caroline Pont (INRAE), Jérôme Salse (INRAE), Jean-Frédéric Terral (Univ. Montpellier), Eric Durand (Inrap), Valentina Bellavia (Geolab), Sarah Ivorra (CNRS), Philippe Marinval (CNRS)